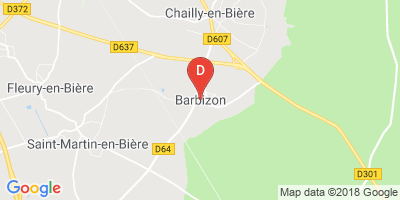Barbizon, le village des peintres
C’est l’histoire d’un petit hameau de bûcherons sans histoire qui se voit envahi au milieu du 19e siècle d’une horde de jeunes peintres, de leurs admirateurs et ensuite de promeneurs (le mot touriste n’existait pas encore).
Lorsque l’histoire commence, Barbizon n’est qu’un modeste hameau habité par des paysans : des carriers qui extraient le grès de la forêt et des bûcherons. Elle n’offre à ses visiteurs que quelques chaumières alignées le long d’une unique rue reliant la forêt à la plaine de Chailly, appelée depuis plaine de l’Angélus. « La vie y est simple et pas chère », écrit George Gassie, un peintre qui y a vécu de 1852 à 1875. Il a connu les artistes que l’on appellera les peintres de Barbizon. Grâce à son livre de souvenirs « le vieux Barbizon » il nous fournit des détails précieux sur l’âge d’or de Barbizon.
Dans les années 1820, le village, entre plaine et forêt, devient un lieu de prédilection pour tous les jeunes artistes en quête de liberté d’expression.

Crédit photos de Aurélie Zeissolff
Ils sont jeunes, insolents, bruyants et passionnés. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont changer le monde de l’art. Ils vont imposer le paysage comme un genre majeur en refusant l’académisme des salons, mais aussi l’habitude de travailler sur le motif. Ils admirent les paysagistes anglais comme Constable, Bonington et Turner, alors qu’en France le paysage ne sert encore que de fond pour la peinture historique, religieuse ou mythologique même si en 1817 on a créé (Henri de Valencienne) le grand prix de Rome de paysage historique.
Le succès de Barbizon tient autant aux peintres qui ont découvert le village et en ont fait profiter leurs camarades d’atelier, qu’à l’initiative d’un couple de Barbizon : les Gannes, après avoir ouvert leur table aux artistes ils achètent vers 1824 une maison de la grande rue qu’ils transforment en auberge (N92 Grande rue ) « Ce capharnaüm pittoresque, hybride de café et vrai vide bouteille de l’art » selon les frères Goncourt est devenu en 1995 le musée de l’école de Barbizon.
Ils sont nombreux ceux qui égayèrent ce séjour classique des paysagistes. Ils ont chanté, ils ont bu, ils ont refait le monde de l’art. Ils recouvrent les murs et les meubles de l’auberge de leurs rêves et de leur fantaisie.
Gassie : « les heures de travail dans ces corps de ferme, d’après nature dans cette belle forêt, cette pleine accidenté de rochers et de beaux bouquets de bois, ou bien pour les peintres d’animaux dans les corps de fermes, dans les étables et les bergeries, ces heures étaient employés sérieusement et devant la nature on ne s’occupait plus que de sa palette et de ses pinceaux. En rentrant on soumettait les études faites dans la journée à la critique quelquefois sévère de ses camarades, ils confrontaient leur travail avec celui des autres. Cette émulation vous faisait faire des progrès, on accrochait à la muraille de la chambrée les études toutes fraîches en se promettant de faire mieux le lendemain ».
Et en effet, lors de la restauration de l’auberge en musée, on a retrouvé sous les papiers peints les traces de ces études peintes ce que les barbizonnais appelait alors les peint’àgannes.
Lieu de rendez-vous : Devant l'Office de Tourisme de Barbizon, place Marc Jacquet